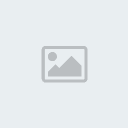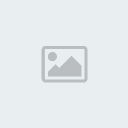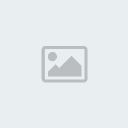yakuza, terme général désignant les organisations criminelles japonaises.
On s’accorde généralement à considérer que le mot « yakuza » provient de la combinaison perdante de l’une des variantes d’un jeu de cartes appelé hanafuda, dans lequel le joueur reçoit trois cartes, le tirage de celles de valeurs 8 (ya), 9 (ku) et 3 (za) assurant une défaite certaine. À partir du XVIIe siècle, les gens plus ou moins marginalisés tels que les guerriers errants — parfois organisés en bandes de voleurs de grands chemins — mais également les joueurs et les vagabonds auraient utilisé cette association malheureuse pour se définir, eux, les inutiles et les bons à rien.
Aujourd’hui, selon la police, les yakuza seraient environ 150 000 (estimation : 1996), répartis en 2 000 « familles » ou kumi. Les spécialistes s’accordent cependant pour penser que ce chiffre est très largement sous-évalué.
On traduirait plus justement le terme kumi par « clan », mais le mot « famille » évoque mieux l’organisation sociale de type patriarcal qui existe chez les yakuza, entre le « patriarche » (le chef de clan, oyabun) et ses « fils » (kobun). Chaque « famille » se compose ainsi de branches aînées et cadettes, et règne sur un territoire qu’elle n’hésite pas à défendre en cas de violation par une famille différente.
Si leurs activités sont officieuses, ces « organisations familiales » ont une existence officielle et légale. Elles apparaissent au grand jour dans les quartiers comme des associations à but non lucratif et les oyabun sont bien connus des services de police. Leur rôle social consiste à protéger la population du vandalisme et surtout des bôsôzoku, ces graines de voyou aux motocyclettes bruyantes qui constituent souvent les futures recrues des yakuza. Elles défendent ainsi les quartiers qui constituent leur territoire et s’attachent à ne pas y troubler l’ordre public : en se regroupant, les rejetés de la société se sont en effet donné une identité particulière et reconnu certaines règles communes. Si la plus importante est la fidélité à sa « famille » d’adoption, une autre est de ne jamais porter préjudice à un katagi, c'est-à-dire à « quelqu’un au travail sérieux », un non-yakuza, tant que celui-ci reste dans la plus stricte légalité, bien sûr…
Les yakuza tirent leurs ressources de tout ce qui est prohibé : jeu, prostitution, armes à feu (totalement interdites au Japon), drogue. Ils perçoivent parfois des redevances pour assurer la protection de commerces ou sociétés. Ils font office d’usuriers, mettant à la disposition de quiconque le demande à peu près n’importe quelle somme d’argent, sans délai ni la moindre question : seule règle, rembourser le capital et les intérêts exorbitants dans les délais impartis, les représailles se soldant souvent, après maintes brimades, par l’assassinat du mauvais payeur et de sa famille.
Les yakuza, leur sens particulier et exacerbé de l’honneur, leurs tatouages impressionnants et l’amputation volontaire de la dernière phalange du petit doigt qu’ils s’infligent pour racheter une faute ayant porté préjudice à leur clan, ont nourri l’imaginaire populaire. La littérature et le cinéma japonais — qui reconnaît le film de yakuza comme un genre à part entière, ninkyô-eiga, « films où le fort défend le faible » — les présentent comme des justiciers courageux, sortes de Robin des Bois des temps modernes, et mettent très souvent en scène le thème du dernier brave d’une famille qui défend, sabre au clair, en des combats disproportionnés et perdus d’avance, à la fois l’honneur de sa famille et les opprimés.
C’est le film américain Yakuza, avec Robert Mitchum et Takakura Ken, qui a révélé à l’Occident cette société mafieuse d’un genre particulier, même si la réalité des guerres de clans modernes est peut-être plus fidèlement retracée dans le film Sonatine du réalisateur japonais Kitano Takeshi.
Extrait encyclopedie encarta
Heiho...